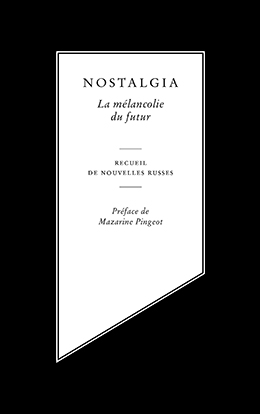Auteurs
Nostalgia
Recueil de nouvelles russes
- Le livre
-
- Les auteurs
-
- Le préfacier
-
- Extrait
-
- Partager

Mazarine Pingeot
« L’âme russe est éternelle », mais cette éternité est chaque fois confisquée par les bouleversements politiques et sociaux dont ce pays est coutumier. Etrange destin de l’éternité que de se nicher dans les îlots de résistance, au creux des grandes vagues de détresse, dans les lignes de fond, les lignes d’écriture, tantôt interdites, tantôt se jouant de la censure, puis s’exhibant à la lumière. Des lignes qui sont plutôt des nœuds, et trimballent avec elle un passé sédimenté qui noyaute l’avenir : une nostalgie. L’âme russe, c’est celle qui a inventé la nostalgie comme une couleur, une note tenue, un accent, et une contagion. Car la nostalgie ne concerne pas seulement le passé, elle grignote le présent et infiltre le futur, déjà condamné par le regret ou déjà confisqué par le frère jumeau de la nostalgie, le fatalisme.
Mais quelle liberté quand on sait que de toute façon c’est foutu ! Quelle liberté d’expier l’éternel châtiment, de boire jusqu’à la lie la énième bouteille de vodka et de vociférer, à condition que ce soit d’une plume de maître !
L’âme russe, elle est là, chez ses écrivains. Et ses écrivains font entendre leur voix dans ce recueil de nouvelles dont le fil rouge est la nostalgie. « C’est toujours ce qui arrive quand on hypnotise les gens pour repousser l’inéluctable. Et à dire vrai, c’est comme avec le pays, ce qui meurt déjà, mourra forcément. », écrit Bykov. Mais ce qui ne meurt pas, ce sont les livres, malgré les autodafés et la censure, malgré l’isolement aujourd’hui d’une certaine littérature russe peu traduite ou pas assez en France, malgré la politique qui toujours se mêle de ce qui lui échappe – et les écrivains ne sont pas hommes à se laisser enfermer -. Les livres ne meurent pas, à condition qu’on les lise, ils ne meurent pas bien qu’ils annoncent tous, d’une manière ou d’une autre, la mort en train d’advenir, la mort déjà là. Et cette infime étincelle des lucioles chères à Pasolini – ces lumières survivantes des contre-pouvoir, continue d’éclairer la nuit russe bien qu’on ne puisse la saisir, fondue qu’elle est dans les faisceaux aveuglants de la grande lumière, celle de la télévision, celle du pouvoir, celle qui cherche à montrer pour mieux cacher, celle qui efface les ombres.
La luciole, prend chez les Russes d’aujourd’hui la double forme du visiteur et du conteur : « je dirais que toute forme de nostalgie n’est qu’un mot, écrit Bykov, glissé en douce, ou un rappel sévère - tu es un visiteur. Que tu te trouves au bout du monde, dans un château de pierres roses ou chez toi, tu n’es qu’un visiteur. Tout au moins, tant que tu es vivant. » une fois mort, le visiteur a pu laisser une trace, elle est là, dans ces mots, dans ce recueil de texte, elle est là qui peut être incessamment lue, méditée, réinterprétée, comme un rappel de notre précarité et de ce point de résistance que constitue l’écriture.
Valéry écrivait « On dirait que l’affaiblissement dans les esprits de l’idée d’éternité coïncide avec le dégoût croissant des longues tâches », et Benjamin renchérissait, « L’idée d’éternité a toujours eu sa source la plus puissante dans la mort. Donc, cette idée s’étiolant, il s’ensuite que l’expérience de la mort elle aussi doit présenter des changements. Cette modification s’avère être la même que celle de l’expérience générale qui a amené le déclin de l’art de narrer », déclin qui semble avoir épargné la littérature russe. Cette figure du conteur, que Benjamin a si parfaitement définie dans son article du même nom, est réactivée par le même Bykov dans sa nouvelle le Prince Taviani, qui raconte la rencontre et le silence de deux anciens amants gênés du fiasco de la nuit. Silence peu à peu empli par un conte qu’ils inventent de concert, le conte dans le conte, l’histoire dans l’histoire…le jeu du conte, le conte entre les êtres pour animer les relations, le vertige du vide, puis le vertige de l’imaginaire, le dialogue des imaginaires à défaut du dialogue des corps, à défaut du dialogue des individus : on a peu faire de l’individu dans la littérature russe, il est balloté, renversé, humilié par le collectif, par le destin, par le passé, encombré, dépouillé, submergé, mais il en reste l’imaginaire, comme ce qui le relie aux autres, aux anciens, aux coutumes, aux provinces et à leurs dialectes, à l’imaginaire collectif. Il est bien là le collectif, dans cet imaginaire dans lequel chacun peut avancer, reculer, jouer sa partition, et inventer la suite, les mille et une nuits comme un antidote à la mort : tant que le conte dure, la mort ne peut advenir, ni la séparation.
Mais à tout conte il y a une morale, équivoque forcément, et la morale de l’histoire, « c’est qu’il ne faut jamais se laisser aller à la nostalgie. Tu comprends ? C’est le sentiment le plus détestable qui soit. Pire que le patriotisme. On se dit tous que c’est noble de se languir pour sa patrie. Or, il n’y a plus de Patrie depuis longtemps, elle s’est complètement transformée. Que sommes nous ? Des bêtes attachées à notre terrier, à notre tanière ? Moins on ressemble à un animal sauvage et mieux c’est, et on ne doit revenir dans aucune Patrie. »1 « Plus de nostalgie » comme une injonction, une injonction contraire car dans cet ordre se redouble le motif même de la nostalgie : serons-nous nostalgiques de ne plus pouvoir l’être ? Non, assurément, la nostalgie est une drogue et une racine, et si la racine n’est plus, au moins la nostalgie en est-elle la trace. Plus de Patrie ? Plus de couple ? Rompre et aller de l’avant ? c’est oublier qu’elle est tout entière là, dans ce vœu pieu de s’en éloigner, on ne s’éloigne pas de la nostalgie, et l’on revient hanter les quartier de Vienne pour Sorokine, le Rostok de l’enfance pour Ivano, la maison de son grand-père devenu musée pour Elena Pasternak. « Les membres de la famille Pasternak avaient en commun de paraître constamment concentrés (sans qu’on puisse dire que c’était de la tristesse ou de la morosité) sur quelque chose d’invisible. Ils vivaient en se référant constamment aux êtres chers qu’ils avaient perdus. On parlait rarement de la mort chez nous, mais sa présence faisait partie de notre vie. C’est pour cette raison que, dans mon enfance, je savais déjà que la mort, « ce n’était pas ce qui arrive aux autres », bien au contraire, cela nous arrivait à nous. » et la mort a frappé plus qu’à son tour, et manqué la maison, témoin de cette vie de famille ; si celle-ci fut expulsée de la datcha de l’écrivain, elle eut le droit d’y revenir sous Gorbatchev, mais cette fois pour y fonder un musée, où la mère d’Eléna devint conservateur en chef. Revisiter sa vie dans un musée, c’est ce qui arrive au visiteur du passé lorsqu’il revient à Vienne : « Toutes les capitales sont condamnées à générer des rêves de musées. Mais elles en ont réellement par-dessus la tête. Les capitales attendent des caresses de la part de leurs visiteurs. Chacune d’entre elles possède ses zones érogènes. Il suffit qu’on les frôle pour que la ville se donne totalement, tombe à la renverse, les jambes écartées, ou – se couche sur vous, vous enivrant de son souffle brûlant. » écrit Sorokine dans Cocktail. Quand au fantôme d’Ivanov, il visite son propre passé : « J’adorais revenir à Rostock en touriste, m’arrêter au Steigenberger et contempler ma ville natale de la fenêtre de l’hôtel, - de la fenêtre d’une chambre à cent-cinquante euros la nuit, - en sachant que ce genre d’extravagances aurait terrassé mon père. Or, il était malheureusement décédé et cela bien avant que je puisse m’offrir ma première chambre à l’hôtel Steigenberger, bien avant que je sois vraiment devenu « l’homme de Rostock ». »
Chacun de ces écrivains est son propre fantôme, la mémoire que l’on veut empêcher revient comme une ombre – « les démons on peut aussi les attraper. C’est comme les maladies vénériennes » fait dire à l’un de ses personnages Prilepine –, charriant avec elle l’idée de la patrie, l’idée de la famille, l’idée de ce qu’on a été, de ce qu’on aurait pu être. Car cette Patrie revient incessamment, s’associant comme son double ou sa métaphore au couple, à la famille, au désespoir.
La patrie apparaît dans un espace équivoque de centralité et de comparatif, tout y ramène et tout s’en sépare, comme une mère abusive qu’on ne peut pas quitter tout en la maudissant. Il est là le malheur russe, elle est là la dette des enfants, ce lien incestueux avec ce grand Autre qui les a engendré et dévoré tout en même temps, la Russie.
« Chacun de nous a son propre cimetière, écrit … dans Ma mère a beaucoup souffert, sa douleur et ses peurs. Nous n’avons que la solitude en commun », oui mais c’est au cœur de la solitude que s’écrivent les livres, pour interpeller d’autres solitudes, et c’est dans ce silence que s’éveille la parole ancestrale du conteur : « Je n’avais plus de passé. Nulle part. Ni dans la ville de mes parents où plus une seule rue ne ressemblait à celles de l’album de ma grand-mère, ni dans celle où j’étais née, ni dans celle de mon imaginaire. » Pourtant celui-ci a pris sa revanche, puisqu’il est devenu l’espace de ce dialogue interrompu, et si nous pouvons revenir « en silence dans notre futur », c’est parce que nous avons d’abord voyagé dans un passé sans réponse, dans un passé comme une origine insaisissable qui toujours nous meut. Revenir dans le futur, c’est là aussi un voyage qu’ose la littérature russe. Car quel que soit le lieu, et même s’il n’existe pas, et même s’il est inventé, nous ne faisons toujours qu’y revenir.
Alors revenons en silence à ces dix-huit nouvelles, qui dressent un tableau de la littérature contemporaine en Russie, où l’adjectif « contemporain » commence déjà à se perdre dans la nuit de la nostalgie, qui est une manière de futur. Nostalgie, dont l’etymon est « douleur du retour ».